Je vous recommande le dossier du journal Les Echos qui souligne le tabou de l’échec, ce qui constitue un obstacle à l’innovation et lie cette difficulté à notre éducation. Exactement les mêmes liens que j’ai pu développer dans mon livre « Prendre des risques pour réussir »
Un Français met en moyenne huit à neuf ans pour se relever après un échec professionnel.
En France, l’échec professionnel reste un tabou, ce qui constitue un frein à l’innovation et à la création d’entreprise. Certains pointent du doigt un système éducatif culpabilisant.
C’était en 1994. Steve Jobs était quasiment seul au milieu des bureaux de Next, la société qu’il avait créée neuf ans plus tôt, après avoir été débarqué d’Apple. Next tentait alors péniblement de changer de modèle économique. Steve Jobs, visiblement déprimé, répondait invariablement « Who knows… » (« qui sait… ») à toutes les questions. Trois ans plus tard, il faisait un retour triomphal chez Apple. Dans les rares interviews qu’il donna à cette époque, il affirmait que « devoir quitter Apple était ce qui lui était arrivé de mieux, car cela l’avait obligé à prendre du recul ».
La vie à rebondissements de Steve Jobs était dans toutes les têtes lors du congrès Failing Forward (« Échouer de l’avant ») 2015, un congrès organisé à Bruxelles en octobre dernier et auquel participaient des créateurs de start-up, des sportifs et des patrons déchus, tous admiratifs de cette Silicon Valley qui semble tout pardonner. « L’échec, nous le voyons à l’américaine : ceux qui prennent des risques et qui apprennent de leurs échecs sont valorisés », a expliqué Cédric Giorgi, ancien fondateur du site de repas chez l’habitant Cookening (qu’il a dû vendre à l’anglais Vizeat) et actuel responsable des relations avec les start-up chez Sigfox (réseau de communication pour objets connectés).
« Qui sait », en effet, ce qui peut arriver dans cette étonnante Californie où les chefs d’entreprise racontent dans des livres comment ils ont digéré leurs échecs, décrivent dans des vidéos leur responsabilité dans la faillite de telle ou telle start-up et participent même à des conférences qui permettent à chacun d’apprendre des erreurs des autres. « Outre-Atlantique, avoir subi plusieurs revers est considéré comme un atout, explique Philippe Rambaud, président de l’association 60.000 Rebonds, qui aide les entrepreneurs français à rebondir après une faillite. Lorsque, à cinquante-trois ans, j’avais fait le tour des « venture capitalists » californiens pour financer mon entreprise, ils m’avaient rangé dans la catégorie des « juniors », car je n’avais pas encore « planté » une ou deux start-up. »
Quel contraste avec la France, et plus généralement avec l’Europe, où l’échec est vécu comme un triple traumatisme : personnel (il faut se remettre en cause), financier (le capital investi est perdu) et professionnel (les collègues vous jettent un regard culpabilisant). « Un Français met huit à neuf ans pour se relever après un échec professionnel, un Allemand, six ans, un Norvégien, moins d’un an », avait énuméré Fleur Pellerin, alors ministre déléguée aux PME et à l’Économie numérique, lors de la Conférence du Rebond qui s’était tenue à Sciences po, en janvier 2014.
La peur entrave l’innovation
Pas étonnant, du coup, que les jeunes Français hésitent avant de se lancer dans la création d’entreprise. « Avant de s’inscrire au mastère spécialisé Centrale – Essec Entrepreneurs, les étudiants viennent me voir : ils s’inquiètent de savoir si un échec éventuel ne les empêchera pas de faire carrière dans un grand groupe », relate Jean-François Galloüin, responsable de cette formation et directeur général de Paris & Co, l’agence de développement économique de Paris.
Bref, la peur de l’échec est un des facteurs qui freineraient la création d’entreprise et, plus globalement, l’innovation. Un constat partagé dans le monde entier. « Pour faire passer les entreprises à l’heure de la révolution numérique, nous devons favoriser une culture de l’innovation et de l’expérimentation, explique Ganesh Ayyar, PDG de Mphasis, une société de services informatiques indienne de 25.000 salariés, filiale de HP. Mais pour cela, les gens doivent pouvoir échouer sans culpabiliser. »
« Du coup, avec leur approche positive de l’échec, les Américains disposent d’un avantage concurrentiel : ils osent parler de leurs mésaventures, ce qui apprend beaucoup aux autres, qui osent encore plus entreprendre », résume le néerlandais Arthur Tolsma, qui dut revendre son entreprise, Greetinq BV (messageries vocales), en 2012. Depuis, il a écrit un livre (« Startups & Downs ») et est devenu coach d’entreprise. Il était l’un des intervenants du Failing Forward 2015. « Je veux faire comprendre que l’échec fait partie du jeu de la création d’entreprise », explique Karen Boers, fondatrice de Startups.be (aide aux start-up), qui organisait pour la troisième fois Failing Forward à Bruxelles.
Le poids de l’éducation
Ces conférences sur le thème de l’échec (voir lexique ci-contre) prouvent que les choses bougent sur le Vieux Continent. Tout doucement. « Pour la première conférence que j’ai organisée à Paris sur ce thème en janvier 2011, j’ai eu beaucoup de mal à trouver des chefs d’entreprise qui acceptaient de parler de leurs échecs, se souvient Roxanne Varza, aujourd’hui directrice de la Halle Freyssinet, l’incubateur géant de Xavier Niel qui doit ouvrir en 2017. Ce fut un peu plus simple pour la deuxième conférence, une FailCon, tout en anglais : les Français étaient moins pudiques, car ils avaient l’impression de s’adresser à des étrangers. » Les causes de cette pudeur européenne sont multiples. Mais tous les observateurs, quelle que soit leur nationalité, insistent sur la responsabilité d’un système éducatif où les bons élèves sont ceux qui restituent sans discuter le savoir transmis par les enseignants.
« J’ai étudié aussi en Espagne et en Angleterre, où la participation et l’expérimentation sont valorisées : le système de notation français n’encourage pas à s’exprimer, ça formate un peu les comportements », estime Camille Bonnet, de l’association Solidarités nouvelles face au chômage. « Ce mode d’enseignement était bon pour former de futurs ouvriers qui allaient répéter les mêmes gestes en usine ; aujourd’hui, il faudrait une éducation personnalisée et qui encourage la prise d’initiative », avance Karen Boers. « C’est malheureusement le genre de choses qui ne se change pas en quelques jours », soupire Ganesh Ayyar. En attendant, restent ces conférences. Et les livres, sur Steve Jobs…
Jacques Henno
Source : http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021520404778-accepter-lechec-un-defi-pour-les-entrepreneurs-europeens
Paulin Dementhon (Drivy) : « J’ai changé de business model »
Après deux ans d’essais, Paulin Dementhon enterre son projet d’application pour mobile à mi-chemin entre Blablacar et Uber. Il décide donc de changer de fusil d’épaule et se recentre sur la location de voitures entre particuliers : Drivy est né.
Promis à une belle carrière de tennisman, Stanislas Niox-Chateau a dû ranger sa raquette après une blessure au dos. Cette frustration lui inspiré, chez Doctolib, dont il est le président et cofondateur, une méthode de management calquée sur l’exigence du sport de haut niveau.
Alors qu’il était sur le point d’opérer un montage financier pour le compte d’une autoroute privée américaine, Jean-Yves Archer, aujourd’hui économiste, s’est fait doubler par un administrateur. Pour rebondir, il a dû revoir la sécurité de ses méthodes de travail.


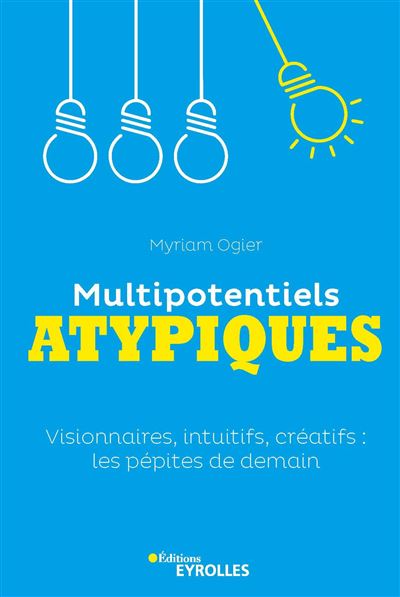

Édifiant ! Pour faire évoluer les mentalités il faudrait que les professeurs, dans les écoles d’ingénieur ou de management, soient parfois des entrepreneurs : tous les entrepreneurs ont connu des échecs ! La transmission de leur vécu serait profitable. Par ailleurs cette intolérance vis à vis de l’échec est aussi l’une des faiblesses majeures des grands groupes. Certes c’est le placard qui sanctionne, pas la faillite. Pour autant le dégât sur les individus est tout aussi destructeur…. Il existe finalement un paradoxe issu de cette observation : le système « individualiste » américain est plus tolérant vis à vis de l’individu que le système « solidaire » européen/français …